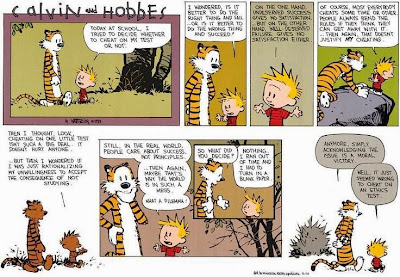Expérimentation animale
L'âge des promesses non tenues
"Ce sont deux économistes qui ont signé ce papier, mais ils y parlent en fait de santé publique. Anne Case et Angus Deaton, le second tout fraîchement adoubé d’un prix Nobel d’économie, décrivent avec une sobre rigueur ce qui pourrait représenter les premières lignes d’une tragédie moderne. Après des années de recul, la mortalité a augmenté chez les Américains blancs âgés de 45 à 54 ans. Ce revers démographique ne touche ni les autres pays riches, ni les autres tranches d’âge, ni les autres groupes ethniques américains. Les Américains noirs par exemple ont toujours une mortalité plus élevée que celle de leurs concitoyens, mais elle continue tranquillement de diminuer. Non, ce sont les blancs parvenus à ce qui devrait être la moitié de leur vie qui sont ainsi touchés, prématurément, par un surcroît de décès. Cette conclusion a survécu à un barrage de critiques méthodologiques dont les plus pertinentes touchaient à la taille de l’effet : l’effet, lui, est bel et bien là.
C’est très impressionnant, ce genre de virage dans une grande tendance. Ça n’arrive pas si facilement. On l’avait vu en URSS, lorsqu’elle existait encore, sur les trois décennies qui en ont précédé la chute. Le signe, avaient déjà dit certains, d’une société qui ne tient plus vraiment ensemble. Cette fois aussi ce sont de grands nombres qui sont concernés par cette surmortalité. Les auteurs font un rapide calcul : si la mortalité de cette tranche d’âge était restée à son niveau de 1998, ce sont 96 000 décès qui auraient été évités. Si elle avait continué de chuter au même rythme qu’entre 1979 et 1998, on serait arrivé à un demi-million de morts en moins. Un taux comparable au total des morts américains du VIH jusqu’en 2015.
Les causes de décès sont impressionnantes elles aussi. En gros, ces personnes meurent de leur propre main. Le cancer pulmonaire ou le diabète ne tuent pas plus qu’avant : ce sont les suicides, les maladies chroniques du foie et surtout les empoisonnements qui ont augmenté.
L’interprétation des auteurs ? Ces personnes décèdent parce que l’histoire les a mises au placard. Ces décès touchent surtout les personnes les moins éduquées, qui meurent à présent 4,1 fois plus dans la même tranche d’âge que leurs concitoyens les plus éduqués. D’autres études montrent une chute simultanée de la santé mentale, de la capacité au travail, et une augmentation de la prévalence de la douleur physique. Des contrôles plus stricts sur la prescription d’opiacés ont conduit certains patients vers l’héroïne de rue. Vient s’ajouter à cela une augmentation de la précarité matérielle depuis 2008. Les délocalisations, le chômage sans filet social. Une sorte d’épidémie, donc, mais pas dans le sens usuel. Une population qui perd le fil de son histoire et voit son avenir se fermer. Une génération éduquée dans le « rêve américain », convaincue de pouvoir améliorer sa vie à force d’effort, pour qui ce récit ne fonctionne plus comme auparavant. Pour eux, le réveil déchante sans doute plus que pour des minorités ethniques d’emblée plus lucides. Une génération qui endure à nouveau la douleur physique sans aide réelle, et succombe à l’addiction. C’est l’âge des promesses non tenues.
Les auteurs, à la fin, sont prudemment optimistes. La douleur et l’addiction sont difficiles à traiter, mais méritent des efforts importants. La perte du récit de sa vie, en revanche, sera plus difficile à aborder. En Europe, nous ne sommes apparemment pas touchés. Nos filets sociaux et nos services publics nous permettent une vie plus sûre, un avenir moins angoissant. Notre faible mobilité évite que le déracinement ne vienne s’ajouter à la marginalisation. Un environnement de travail plus humain, une histoire en dehors du travail, tout cela est protecteur. Une conclusion à laquelle la science économique ne nous avait pas habitués…"
La SSEB, vous connaissez?
En ce moment, je vous écris depuis le très joli couvent de Bigorio, au Tessin, où nous avons une fois par année une réunion où ceux qui font de la recherche la présentent. Une collègue infirmière nous raconte les résultat d'une étude qu'elle a réalisée en EMS sur la manière dont les professionnels composent avec la nécessité, et la difficulté souvent, de respecter les volontés des résidents sur les soins médicaux. C'est nuancé, intéressant, cela intriguerait certainement pas mal de gens parmi vous. Notre prochain événement va être un symposium en avril sur la consultation d'éthique clinique. Nous publions quatre fois par année la revue Bioethica Forum, dont l'abonnement est inclus pour les membres de la SSEB. Certains d'entre vous y ont d'ailleurs écrit. Si vous allez regarder le site, vous verrez que les numéros sont en accès libre après quelques temps. C'est la Suisse, on est polyglottes, mais cela veut aussi dire que vous trouverez des choses en français. Allez y faire un tour: je pense que ça va vous intéresser...
Mes collègues: libido noscendi
Maintenant le texte: comme d'habitude, je vous met aussi le lien.
"Le New York Times du 5 novembre nous informe que le procureur général de l’État de New York a ouvert une information judiciaire à l’encontre de la société Exxon, soupçonnée d’avoir dissimulé des données sur le changement climatique qu’elle détenait de longue date. Les chercheurs d’Exxon avaient travaillé sur la question dès les années septante et renseigné les dirigeants de la société pétrolière sur les dangers liés au réchauffement climatique. Mais par ailleurs, Exxon alimentait généreusement les campagnes de désinformation climato-sceptiques. Des révélations à ce sujet avaient déjà paru mais c’est la première fois que des conséquences judiciaires s’en suivent.
Les commentateurs ont relevé des analogies avec les activités de l’industrie du tabac. Dès les années cinquante, celle-ci menait ses propres recherches toxicologiques sur la nocivité de la fumée, tout en niant ces risques et en finançant des chercheurs chargés d’entretenir le déni ; puis le doute, dès lors que la négation pure et simple n’était plus crédible. On se souvient de l’affaire d’un scientifique sous influence de Philip Morris qui avait fait beaucoup de bruit à Genève au début des années deux mille. Le chercheur en question, professeur associé à l’Université de Genève, avait eu à l’insu de celle-ci un rôle dirigeant dans des recherches secrètes sur les effets toxiques de la fumée secondaire, tout en participant aux efforts de mise en doute de ces dangers vis-à-vis du public. Ce double langage mettait crûment en évidence la duplicité de l’industrie du tabac et lui fut très dommageable dans les poursuites qu’elle encourut devant les tribunaux américains. Car tout en prêchant le faux, l’industrie était curieuse de savoir le vrai et c’est ce désir de savoir qui l’a piégée en définitive. Ses managers n’avaient peut-être pas lu Saint Augustin sur les curiosités malsaines …
Il est trop tôt pour savoir si les industries des énergies fossiles connaîtront un destin judiciaire semblable à celui des cigarettiers : des années de procès avec à la clé des amendes se montant à des dizaines de milliards de dollars. Il semble qu’une partie des recherches menées par Exxon étaient publiées et ne défendaient pas nécessairement des conclusions climato-sceptiques. Mais si l’enquête devait confirmer la dissimulation intentionnelle de résultats concernant l’évolution du climat, la sanction pourrait être particulièrement sévère. En effet, selon des sources anonymes citées par le New York Times, l’enquête est motivée par un soupçon de fraude financière, en l’occurrence d’avoir caché aux investisseurs des renseignements sur le changement climatique susceptibles d’affecter la profitabilité de l’industrie. Car enfumer le bon peuple, c’est assez inélégant certes… mais tromper des acteurs financiers importants qui pourraient perdre beaucoup d’argent, ce n’est vraiment pas bien du tout. Des fractures politiques pourraient apparaître au sein de la droite américaine. Le climato-scepticisme est la religion commune à tous les candidats républicains. Ceux-ci pourraient donc se retrouver en porte-à-faux avec leurs soutiens traditionnels dans le monde économique, tout en creusant leur décalage avec l’opinion publique : les trois quarts des Américains (dont 59 pour cent d’électeurs républicains) pensent désormais que le changement climatique est une réalité . Nul doute que ce thème s’invitera au premier rang des débats de la campagne présidentielle."
Mes collègues: mesures de protection
En tout cas voilà le résumé:
Le secret professionnel est au cœur de la tension qui peut exister entre le respect de l’autonomie du patient et la nécessité de lui apporter l’aide nécessaire en situation de vulnérabilité ou de danger. En sus des exceptions obligatoires et non obligatoires au secret médical, le nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit, à l’article 453 CC, que les personnes liées par le secret professionnel ou de fonction pourront signaler à l’autorité de protection la situation d’un patient qui mettrait en danger sa vie ou son intégrité corporelle, ou représenterait ce type de danger pour autrui. Cette disposition ne devra être utilisée qu’en dernier recours, lorsque la personne concernée ne consent pas à la transmission des informations nécessaires et que tout autre moyen d’aide aura été inopérant.
Allez le lire. Pour certains d'entre vous, ça va être une référence à garder sous la main pour mieux comprendre, et appliquer avec la parsimonie qui s'impose, cette nécessaire possibilité...
Vaccination
La radio vient de rediffuser une émission à laquelle j'avais participé autour de la vaccination. C'était dans Babylone, et c'était en regard croisé avec deux excellentes collègues dont je devrais vous donner plus souvent des nouvelles dans ce blog. Claudine Burton Jeangros est sociologue, et son regard sur le domaine de la santé est toujours original et à chaque fois véritablement intéressant. Claire-Anne Siegrist, dont nous commentions la conférence, est une des actrices centrales de notre pays dans le domaine de la vaccination. L'émission se trouve ici, la conférence, qui ouvre ce billet, est ici. Allez écouter et revenez nous dire ce que vous en aurez pensé!
Le dépistage non invasif de la trisomie 21
Voici comme d'habitude le texte et le lien:
"Avant de me confier mes premières consultations prénatales, on m’avait soigneusement appris toute une série de choses. Parmi elles, le diagnostic de la trisomie 21. Dans le scénario typique, la grossesse était débutante et la consultation servait d’abord à la confirmer. Lorsqu’il s’agissait d’un événement heureux, c’était le moment du sourire au coin des yeux et des rêves tout roses. Et puis…et puis il fallait demander : En cas de trisomie 21, que feriez-vous ? Grand virage, là. On aurait presque vu les chaussons tricotés par la grand-mère virer aux images métalliques d’amniocentèse dans le regard intérieur des futurs parents. Mieux valait ne pas poser la question de but en blanc ; mais ce virage n’était pas entièrement évitable.
Le dépistage comportait déjà à cette époque une étape initiale dont le résultat était un rapport de probabilité. Inférieur à 1/200, le test était considéré comme négatif. Ce seuil atteint, l’amniocentèse était considérée comme indiquée pour les parents qui souhaitaient connaître le diagnostic. Arrivés à ce stade, il n’était cela dit plus vraiment temps de se demander si l’on voulait savoir ou non. Même pour ceux qui n’avaient pas déjà décidé d’interrompre en cas de trisomie, l’incertitude devenait souvent plus pesante que le risque lié à la ponction. Pour réfléchir posément, il fallait se poser la question avant le test initial. D’où la question durant la première consultation ; d’où le virage serré de cette fameuse conversation.
Cette conversation ne semble jamais avoir été une attitude établie pour tous. Ce n’est pas vraiment surprenant. Le test est après tout rassurant dans la majorité des cas : on peut comprendre que des confrères hésitent à troubler à ce point des futurs parents heureux. Une explication qu’un certain nombre de tests sont habituels en début de grossesse pour ‘vérifier que tout va bien’ tient lieu de consentement éclairé, et lorsque les résultats sont rassurants ça passe comme une lettre à la poste. Le hic, c’est évidemment que parfois ce n’est pas le cas. Pour ces couples-là, le moment d’une décision libre et réfléchie est alors passé avant d’être arrivé.
C’est dans ce scénario qu’arrive le dépistage non invasif de la trisomie 21, rendu possible par une analyse de l’ADN fœtal dans le sang maternel et dont la couverture par l’assurance maladie a été acceptée cet été. Que va-t-il changer ? En ajoutant à la précision du test initial, il va permettre de diminuer le nombre d’amniocentèses. Un progrès. En faisant intervenir un test ADN avant le stade invasif, il va introduire dans cette étape du dépistage les exigences qui accompagnent les analyses génétiques humaines, entre autres celle d’un conseil non directif, d’une vraie information. Là aussi, c’est un progrès.
Pourtant, ce test a fait controverse. Pourquoi ? En augmentant l’efficacité du dépistage de la trisomie 21, certains craignent que l’on n’améliore « l’efficacité » avec laquelle on empêchera dorénavant la naissance d’enfants atteints de trisomie. La crainte est ici également que ce ne soit justement ce que nous souhaitons faire.
La réalité est cependant que le test non invasif ne va pas limiter le nombre de personnes qui naîtront avec une trisomie 21. Ceux qui procèdent aujourd’hui à la démarche diagnostique continueront de le faire, avec à la clé un risque plus faible d’avoir besoin d’une amniocentèse. Ceux qui ne veulent pas savoir continueront de ne pas initier le processus. Avec l’addition d’un test génétique on peut même espérer que la décision des couples sera mieux réfléchie, et aura lieu dans de meilleures conditions. La crainte de ce test est donc exagérée, tout comme l’espoir (réel ou supposé) contre lequel cette crainte réagit. Un peu comme si nous étions des enfants, qui auraient peur de leur ami imaginaire… "
Que la crainte de cet outil technologique soit déplacée, cela ne veut pourtant pas dire que toute crainte est déplacée. Ces choix se font dans un contexte. La trisomie 21, cela fait très peu de temps par exemple que c'est reconnu comme un handicap congénital. Ne pas le reconnaître, c'est mettre les parents devant des obstacles évitables. C'est leur rendre plus difficile l'accès aux aides dont ils seront nombreux à avoir besoin, et dont leurs enfants seront nombreux à avoir besoin eux aussi pour mener une existence qui soit la meilleure possible. C'est sans doute aussi influencer leur choix devant un résultat positif lors d'un dépistage. Dans notre fascination pour les progrès technologiques, il est bon que nous n'oublions pas d'examiner aussi et parfois de corriger ce genre de chose...
Les idéologies antisciences
C'est un blog de bioéthique, donc je ne vais pas vous faire à chaud un commentaire sur les attentats de Paris. A la place, je vais profiter qu'une magnifique conférence vient d'être mise en ligne pour vous la recommander. Il s'agit de la leçon d'adieu (enfin, d'au revoir) d'Alex Mauron, notre pionnier de l'éthique biomédicale qui de temps en temps écrit ici. En plus elle n'est pas entièrement sans lien: il y parle des idéologies antisciences. Autrement dit du dénisme sous ses différentes formes. Allez la regarder et ensuite venez nous dire ce que vous pensez. C'est ici.
Si on ne peut même plus rigoler...
"Cette anecdote est véridique, nous sommes dans un service d’urgence américain. Des internes affamés ont commandé une pizza quand on leur annonce une victime de plaie par balle. Ils font tout pour sauver la vie d’un jeune homme mortellement blessé, mais en vain. Il s’agissait du livreur de pizza, attaqué alors qu’il s’approchait de l’hôpital. Une fois le calme revenu, il trouvent la pizza sur le pas de la porte, parfaitement comestible. Ouvrant la boîte l’un d’eux demande : « Combien vous pensez qu’on devrait lui donner comme pourboire ? ». Ils rient, et ils mangent la pizza.
L’humour médical existe sous toutes sortes de formes et il peut choquer les personnes qui le découvrent. Des générations de stagiaires ont vécu le décalage. Nous devons à nos patients beaucoup de respect et de politesse. Alors que vient faire là l’humour parfois très cru qui s’échange entre nous ? La réponse la plus évidente : c’est un exutoire nécessaire, une façon de rendre supportable les fardeaux de souffrance humaine qui nous sont confiés. Ceux qui rient le plus fort sont souvent les plus affectés par le sort de leurs patients.
Nécessaire et légitime, l’humour médical a cependant une face plus sombre. Cette fois nous sommes dans une salle d’accouchement, toujours aux Etats-Unis, et l’obstétricien vient de sauver la vie d’une femme hispanique en pleine hémorragie du post-partum en procédant sous narcose à un massage utérin interne. Soulagé et heureux, une main encore dans son vagin, il lève l’autre main en l’air et se met à danser en chantant ‘La Cucaracha, la cucaracha…’ . Ici, l’anesthésiste l’arrête sèchement. Cette histoire vient d’être publiée anonymement, des années plus tard, avec une honte palpable. Les éditeurs du journal ont longuement débattu de sa publication. Ils s’expliquent dans un éditorial et semblent partager une part de cette honte. Une borne a été franchie.
Ces bornes, donc, existent. Mais où sont-elles et comment les respecter en évitant de tomber dans un moralisme frileux qui interdirait tout bonnement l’humour ? Se livrant à un exercice plutôt rare en éthique médicale, la juriste Katie Watson nous propose une analyse fine qui catégorise l’humour selon ses fonctions . Entre les lignes de nos plaisanteries, ce sont toutes sortes de messages que nous communiquons et ce sont eux qui font la différence. Nous plaisantons pour dire la vérité plus vite à un collègue. Comme c’est efficace, nous nous en servons parfois comme outil rhétorique, pour mettre la critique de notre côté. C’est déjà plus douteux. Nous nous en servons souvent pour rire de ce qui exerce un pouvoir sur nous, pour rétablir un tant soit peu une réalité où le déséquilibre serait trop insupportable sans lui. Les cibles de l’humour noir sont ici la maladie, la détresse ou, comme dans le récit du livreur de pizza, la mort elle-même. Cet humour est nécessaire, vital. Il nous permet de survivre, de sourire, et d’aller (parfois directement) voir le patient suivant. Nous ne devons surtout pas en avoir honte. Nous nous servons de l’humour pour nous montrer solidaire les uns envers les autres, pour partager nos peines.
Nous pouvons cependant aussi nous en servir pour exclure. Pour souligner à quel point les patients sont différents de nous, pour les déclarer coupables de ces maux que nous souffrons tant de ne pas pouvoir mieux soulager. Cet humour-là frappe plus faible que nous et cela, oui, cela peut poser problème.
Katie Watson offre une clé de lecture : Qui est visé par la plaisanterie ? Peut-elle limiter la qualité de nos soins ? Peut-elle nous soulager trop vite et nous ôter la motivation de changer une situation inacceptable ? Qui écoute et pourrait en souffrir? Une lecture utile, qui aide à comprendre où sont les bornes sans nous interdire, finalement, de rire."
Reprenons!
Donc, reprenons.
Là, le truc qui me démange le plus est une nouvelle qui nous vient d'outre-Atlantique. Le patron de Turing Pharmaceuticals, un jeune manager dont on précise que c'est un ancien des hedge-funds, a récemment "acquis la Pyrimethamine", un médicament utilisé pour soigner la toxoplasmose, entre autres chez les personnes atteintes du VIH. Ce n'est pas si clair que ça, ce que signifie cette acquisition, parce que c'est un vieux médicament dont le brevet est échu depuis longtemps. Du jour au lendemain, pourtant, il en a fait passer le prix de $13.5 à $750 par comprimé. Oui, vous avez bien lu, pas d'oubli de virgule là dedans, on a multiplié le prix par 55. Une indignation générale s'en est bien sûr suivi.
Le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle n'est en fait pas du tout isolée. Sur plusieurs fronts, les prix des médicaments sont en augmentation. Certains exemples, comme celui du Sofosbuvir contre l'hépatite C, concernent des médicaments nouveaux et très efficaces. D'autres sont, dirons-nous, moins efficaces. Certains, comme la Pyrimethamine, ne sont pas nouveaux. Ici, il a été possible d'augmenter le prix à ce point parce qu'il a été possible d'acquérir le contrôle sur la chaine de production et ainsi maintenir une rareté qui n'aurait en fait pas lieu d'être. En fait, contrôler la production rend l'accès à la molécule difficile pour ceux qui voudraient en faire un générique. Ils peuvent la fabriquer, mais ils ne peuvent ensuite pas si facilement en démontrer l'équivalence avec la formule d'origine. Du coup, ils ne peuvent pas avoir d'autorisation de mise sur le marché. Pour le propriétaire du médicament original, c'est une sorte de prolongation du monopole qui devient possible bien au-delà de la protection par le brevet d'origine.
Alors oui, parfois le développement d'un nouveau médicament coûte tellement cher que dégager même un bénéfice modeste va nécessiter un coût de vente élevé. On pourrait débattre de ces cas aussi mais pour maintenant laissons-les de côté. Les cas qui ont été critiqués ces dernières années ne sont pas comme ça. La Pyrimethamine, et d'autres médicaments en situation semblable, semblent vraiment être vendus au prix le plus élevé que le marché pourra prévisiblement supporter. Du coup, cela ressemble carrément à du racket: "Vous avez besoin de ce truc, nous l'avons, passez la monnaie." Les fabricants qui tentent de se racheter de la réputation en réservant une part de ces médicaments désormais de luxe aux démunis ressemblent sous cet angle de plus en plus à des parrains de la mafia qui feraient la charité aux pauvres.
Il y a eu beaucoup de réactions à cette nouvelle. Certaines sont sur un site anglophone de philosophie auquel j'ai contribué un billet que je vous traduis en partie ici. La réaction la plus facile est évidemment de blâmer les personnes qui ont décidé de ces augmentations de prix. L'indignation a ici été telle que le patron de Turing a annoncé deux jours plus tard qu'il revenait sur sa décision et que le nouveau prix "serait plus modeste". Aucun montant n'a apparemment été révélé. Mais blâmer le décideur n'est que la réaction la plus immédiate. Il est plus intéressant de se demander comment une telle chose est devenue possible. Une partie de la réponse est que, même si nous sommes d'accord que faire du profit en découvrant, en développant, et en vendant un médicament est légitime, nous n'avons jamais vraiment clarifié d'où en sortait la justification. Peut-être que nous approuvons ce profit parce que nous pensons que les efforts et la créativité qu'impliquent le développement d'un nouveau médicament mérite une rémunération. Peut-être que nous considérons que la manufacture de ce médicament, lui aussi, mérite un paiement. Peut-être sommes-nous prêts à payer pour la valeur ajoutée que le médicament apporte par rapport aux alternatives. Peut-être que nous ne considérons en fait pas (seulement) le mérite, mais plutôt les conséquences: nous voulons donner un incitatif pour le développement d'innovations thérapeutiques. Peut-être voulons-nous aussi permettre que l'accès aux traitement médicaux dont nous avons besoin nous reste garantis par le moteur que représente le profit.
Ce qui est fascinant dans cette histoire de la Pyrimethamine, et dans d'autres cas semblables, c'est à quel point c'est évident que ces justifications ne marchent pas. Il est très clair que tout effort investi dans le développement de ce médicament a depuis longtemps été récompensé. Tout profit qui en découle désormais n'est pas mérité dans ce sens là. La fabrication coûte certainement encore de l'argent, mais elle ne peut clairement pas justifier un prix aussi élevé. La valeur ajoutée est elle aussi absente: c'est le même médicament qu'avant, après tout. Finalement, loin de protéger l'accès, la stratégie du fabricant semble ici faite exprès pour le limiter.
Pourtant, selon toute apparence, cette décision est parfaitement légale. Voilà donc une situation où notre confusion collective a des coûts réels. Des coûts financiers, et aussi des coûts humains. Car d'une part, nous consentons collectivement à ce que l'on puisse créer la rareté et ainsi demander des prix élevés. D'autre part cependant, nous restons des êtres pourvus de besoins vitaux. Autoriser la vente à n'importe quel prix des produits qui répondent à un besoin vital, c'est autoriser notre propre prise en otage. C'est vrai dans les cas comme celui d'aujourd'hui, mais pas seulement. Et si cela ne nous plait pas, il va falloir nous organiser autrement.
Décidément, il est temps de légaliser le diagnostic préimplantatoire
Alors oui, décidément il est temps de légaliser le diagnostic préimplantatoire. Mais commencez par aller lire leurs histoires. Après, revenez pour nous dire ce que vous en pensez...
L'éthique des éthiciens
La réponse est intéressante. En bref, on doit rester humbles. Et prudents. Eric Schwitzguebel, que vous pouvez écouter ici, a même fait de cette question sa spécialité. Il a commencé par regarder, assez simplement, si les livres d'éthique manquaient moins que les autres dans les bibliothèques. La réponse? Ils y manquent exactement comme les autres sauf que si on se focalise sur les titres qui ne seront vraisemblablement empruntés que par des éthiciens ou des étudiants en éthique alors ceux-là manque plus... Argl. Les professeurs d'éthique ne répondent pas plus souvent que les autres aux emails de leurs étudiants (la moyenne aux USA est de ... environ 55%). Les éthiciens sont par ailleurs plus nombreux à condamner la consommation de viande, mais ils sont exactement aussi carnivores que les autres.
Il semble donc que les éthiciens soient semblables, voir un légèrement moins bons, que les autres. Alors, tous hypocrites? Pas si vite! Il y a plusieurs explications ici, et il y en a encore d'autres ici.
D'abord, il y a des explications confortables pour nous. Il y a par exemple tout simplement une différence entre savoir quelque chose sur ce qu'il serait bon de faire et le faire pour de vrai. Dans ce sens, la morale des éthiciens c'est un peu comme la santé des médecins. Savoir comment prendre soin de soi ne signifie de loin pas le faire. Si je vais voir un médecin pour ma propre santé ce n'est pas par admiration pour la sienne, c'est parce que j'ai confiance en ses connaissances.
Certains argumentent même que ce serait dangereux d'exiger de nos éthiciens qu'ils suivent en tous points leurs propres conclusions. Pourquoi? Parce qu'ils risqueraient alors d'être tentés de conclure faussement simplement pour arriver à une conclusion plus facile à appliquer. Si par exemple la question est "Combien d'aide devrions-nous donner aux personnes distantes qui en ont besoin?", il est plausible que la réponse donne nettement plus que la plupart d'entre nous ne le fait. Un éthicien pas particulièrement généreux, ou qui se sent dans le besoin, pourrait être tenté d'arriver -faussement- à une conclusion plus modeste s'il était tenu ensuite d'appliquer ses propres conclusions. Pour reprendre l'exemple de la médecine, un médecin tenu de suivre toutes les recommandations de la médecine et qui n'aurait pas le temps de faire du sport pourrait être tenté de conclure -toujours faussement- que ce n'est pas si grave pour sa santé. En tant qu'être humain, nous sommes constamment tentés de raisonner pour confirmer nos envies plutôt que pour arriver à une conclusion juste. Dissocier la conclusion et le comportement, dans cette logique, c'est une manière de s'assurer que les conclusions sont les plus justes possibles. C'est presque une manière d'éviter un conflit d'intérêt.
Ensuite, il y a les explications plus inconfortable pour nous. On sait par exemple qu'une partie de nos intuitions morales fonctionne un peu comme un thermostat. Si nous avons déjà (ou si nous pensons déjà avoir) des raisons de penser du bien de nous-mêmes, alors nous avons tendance à être plus cool avec notre comportement la fois d'après. Si on demande à des personnes de se décrire en utilisant des mots favorables, à d'autres personnes de se décrire en utilisant des mots neutres ou défavorables, et qu'on leur donne ensuite l'option de se faire payer pour leur exercice ou de donner l'argent à une bonne oeuvre, et bien ceux qui se sont décrits favorablement donnent moins que les autres. On a, littéralement, très facilement l'impression d'avoir "déjà donné". Ce phénomène du "thermostat moral" signifie que les éthiciens seront à risque de se comporter moins bien que d'autres dans la vie ordinaire s'ils ont souvent l'occasion de penser qu'ils font quelque chose de bien. En fait, tous les métiers d'aide sont ici à risque. Si vous passez votre vie à faire des choses pour les autres, vous aurez souvent l'impression d'avoir "déjà donné". Si les éthiciens font partie de ce lot, c'est que nous exerçons en fait un métier à risque, plutôt qu'un métier protecteur.
Et finalement, il pourrait y avoir là un mécanisme semblable à celui qui conduit les médecins (j'en sais quelque chose) à être parfois de très mais alors de très mauvais patients. En bref, le cerveau qui fabrique le déni est toujours le vôtre, donc il sait les mêmes choses que vous. Si vous êtes médecin et malade, le cerveau qui vous fait le déni et vous pousse à penser que vous n'avez rien de grave, eh bien il a aussi étudié la médecine et il vous fait un déni très très efficace. Si vous êtes éthicien et que vous vous cherchez une excuse morale, elle sera vite très convaincante.
Bigre. Il va donc vraiment s'agir d'être humbles. Et prudents. Mais en tout cas, on va devoir revoir l'idée selon laquelle les éthiciens seraient, comme ça automatiquement, plus moraux que les autres...
Il est temps de légaliser le diagnostic préimplantatoire (3)
Il y a plusieurs raisons. A mon avis, elles ne tiennent pas. En tout cas, elles ne tiennent pas comme raisons de continuer d'interdire le DPI. Mais c'est évidemment ici que je vais vous parler des désaccords. Dites-nous donc ce que vous en pensez dans les commentaires...
Alors allons-y:
Si le DPI soulève à ce point la controverse alors qu'il serait tellement décent de l'autoriser, c'est en partie parce qu’il touche à l’embryon. Et évidemment, le statut de l’embryon est une question qui nous divise. La loi actuelle, cependant, permet le diagnostic prénatal et l’interruption de grossesse. En d’autres termes, en interdisant le diagnostic préimplantatoire, nous protégeons davantage un embryon de huit cellules qu’un fœtus nettement plus formé de 14 semaines. Ce n’est pas défendable.
Certains craignent que l'autorisation d'analyser les gènes ne donne aux parents l'envie de choisir sur cette base un 'enfant parfait', 'zéro défauts', comme sur catalogue. Qu'ils en aient envie...sans doute: cela fait partie du fait de devenir parent, ça, d'avoir plein d'envies irréalistes et d'ensuite faire la connaissance d'une vraie personne qui est différente de tout cela et qui nous surprend. Qu'ils en aient envie, donc, oui sans doute. Mais la technique ne le permet tout simplement pas. Il faudrait pour cela être capable de tout voir dans les gènes, et ce n'est pas possible. Même si nos connaissances étaient beaucoup plus avancées, nos gènes ne nous résument en fait pas à ce point là. En plus, même en supposant qu'on puisse vraiment lire le destin entier de quelqu'un dans son génome, il faudrait ensuite un nombre immense d'embryons pour en choisir un qui soit 'parfait'. Pas possible d'obtenir autant d'ovules, c'est une limite biologique.
Le diagnostic préimplantatoire soulève aussi des craintes d’eugénisme. Mais en fait, les parents qui décident d’y avoir recours n’ont pas ce genre de motivation. En plus, il s’agit ici de leur donner des choix. On est donc loin de l’eugénisme. D'ailleurs un des problèmes de l'eugénisme était précisément l’intrusion de l’état dans des décisions reproductives personnelles. Même si on en reste de toute manière très éloigné, on s'en approche en fait plus en interdisant le DPI qu'en l'autorisant.
Certains craignent malgré cela que les parents se voient contraints par la pression sociale, que ce choix ne soit qu’une illusion. Mais alors la solution n’est pas l’interdiction du diagnostic préimplantatoire : c’est le conseil génétique non directif et la protection en consultation médicale de la liberté de choix des parents.
Certains ont aussi peur que l'autorisation du DPI ne devienne un moyen pour empêcher toujours plus d'enfants handicapés de naître. Cette crainte est touchante, parce qu'elle révèle à quel point nous exagérons le pouvoir de la génétique, et de la médecine en général. En fait, même si nous nous mettions tous à faire des enfants exclusivement in vitro et même si après cela nous avions tous recours au DPI, et encore même si nous examinions toutes les causes connues de handicap liées à la génétique, nous n'obtiendrions pas un monde sans handicap. On peut s'en réjouir ou le déplorer, mais l'important est de le constater. Un nombre croissant de handicaps sont actuellement liés à des causes qui ne sont pas génétiques. Même les causes génétiques ne sont pas toutes connues, et donc on ne sait pas les identifier. En plus, il n'est pas question d'autoriser l'examen de tous les gènes. Si le DPI est autorisé en Suisse, ce sera pour une catégorie très limitée d'anomalies génétiques. Et puis bien sûr, on ne s'attend pas vraiment à voir tout le monde remplacer subitement la procréation 'maison' par la médecine.
Finalement, les associations de défense du handicap nous rendent attentifs au risque de stigmatisation de personnes handicapées si leur maladie venait à être étiquetée comme raison de ne pas implanter un embryon. Ce souci, il faut l’entendre. La loi ne prévoit par conséquent effectivement pas de nommer de maladies mais définit à la place un cadre strict. C'est en fait ici que se situe les enjeux les plus réels. Le projet de loi a fait l'objet de discussions très nourries, et il est finalement arrivé à proposer une solution raisonnable, et très prudente, à un problème difficile. Le cadre, comme il est prévu, ne va pas faire de mal aux personnes qui vivent avec un handicap. Évidemment, on n'aura rien fait non plus pour elles avec cette loi. Leur situation restera inchangée. Cela aussi il faut l'entendre. Nous devons continuer de faire mieux, effectivement, pour donner à tous les moyens de vivre une vie entière et digne même lorsque leurs besoins sont différents.
Mais pour faire cela, continuer d’interdire le diagnostic préimplantatoire ne serait d’aucun secours. En fait, il s’agirait d’une mesure alibi. Elle serait tout juste bonne à nous donner bonne conscience à bon marché. Et on se ferait cette fausse bonne conscience sur le dos de parents déjà lourdement frappés par le sort, et de couples qui ne veulent rien d'autre qu'un enfant, tout simplement.
Nous avons donc interdit le DPI, mais en y regardant de plus près il n'y a pas de bonne raison de maintenir cet interdit. Alors en l'absence d'une bonne raison d'interdire, au nom de quoi, finalement, voudrions-nous décider à la place des couples concernés? Et voilà: une troisième raison pour laquelle il est temps de légaliser le DPI...
Il est temps de légaliser le diagnostic préimplantatoire (2)
Je vous le disais dans le dernier billet, c'est un geste un peu (pas mal) technique. Je vous avais déjà parlé de certains de ses enjeux ici et ici. C'est aussi un geste qui ne concerne directement que peu d'entre nous. Heureusement, les maladies héréditaires graves sont rares. Mais le DPI sert aussi à autre chose: il améliore l'efficacité de la fertilisation in vitro. Et là, nettement plus de personnes sont concernées. Là, vous connaissez en fait certainement (peut-être sans le savoir) quelqu'un qui aurait été heureux que le DPI soit légal en Suisse. Pourquoi? Pour le comprendre, il faut aller voir de plus près une autre histoire.
Imaginez cette fois que vous essayez de faire un enfant mais que cela ne marche pas tout seul. Vous finissez par consulter un médecin et il se trouve que vous allez devoir avoir recours à la fertilisation in vitro. Vous devrez ici remplir un certain nombre de conditions: être mariés, être suffisamment jeunes pour pouvoir élever votre futur enfant jusqu'à sa majorité. Si ces conditions sont remplies, vous (ou votre femme si vous êtes un homme) allez devoir subir une stimulation hormonale puis un prélèvement d'ovules. Ces ovules, en nombre variable mais forcément limité, seront ensuite mis en contact du sperme de votre mari. Le résultat, si tout va bien, sera un certain nombre d'ovocytes imprégnés.
A ce stade, la loi actuelle permet d'en développer trois jusqu'à un stade où ils peuvent être implantés. Les autres seront congelés et pourront servir à de nouvelles tentatives si ça ne marche pas la première fois. En 2013, 10'975 tentatives ont été faites chez 6180 femmes, et il en a résulté 1891 naissances. En fait, ça n'a marché que pour un peu moins d'un couple sur trois. Pas rien, mais pas non plus immense, comme résultat. Ensuite, évidemment, les couples chez lesquels ça ne fonctionne pas du premier coup peuvent recommencer, mais c'est à chaque fois très éprouvant, cela signifie des fausses couches en partie évitables, et en plus ce n'est pas (mais alors là pas du tout) gratuit.
Le rapport avec le DPI? En fait, une partie des embryons qui ne donneront pas de grossesse, ou qui donneront une fausse couche, on est capable de les identifier si on examine leurs chromosomes. Ce n'est pas une analyse génétique fine. Entre l'analyse génétique et l'examen des chromosomes, il y a une différence qui ressemble un peu (un peu) à la différence qu'il y a entre faire la liste du nom et du domicile de tous les habitants de Suisse d'une part, et d'autre part simplement regarder la taille et l'emplacement des cantons. Les chromosomes, c'est un peu comme les cantons. On voit s'il y en a un qui manque, ou s'il n'a pas la bonne taille ou pas la bonne forme, mais ça ne permet pas de savoir s'il manque une personne à telle ou telle adresse.
Sauf qu'avec la loi actuelle, regarder quels sont les embryons qui ne vont pas donner de naissance, c'est interdit. On est obligé de les implanter tous, trois par trois, et de vivre avec ce taux d'échec alors que l'on sait qu'une analyse assez simple permettrait d'améliorer la technique et de permettre plus de naissances, plus vite, chez un plus grand nombre de couples.
Et voilà, une deuxième bonne raison de légaliser le DPI.
Il est temps de légaliser le diagnostic préimplantatoire (1)
Voilà la première: imaginez qu’une amie vienne vous parler d’un cas de conscience. Sa famille vient de traverser une tragédie. Lors de la naissance de son premier enfant, une maladie génétique rare a été découverte chez lui. Cet enfant n’a jamais pu se développer normalement, et il est décédé en bas âge. A présent, elle et son mari souhaitent avoir un autre enfant. Seulement voilà, ils se savent désormais porteurs de cette maladie, qui peut également survenir lors d’une nouvelle grossesse. Que faire ?
Actuellement, la loi Suisse est claire. S’il veut éviter de revivre ce qu’ils viennent de traverser, ce couple peut adopter, renoncer à fonder une famille, ou alors ils peuvent mettre en route une grossesse ‘à l’essai’. Ils peuvent concevoir un enfant, le porter pour le premier trimestre, pratiquer un diagnostic génétique prénatal, puis interrompre la grossesse si le fœtus est porteur de la même maladie. Là est le cas de conscience que se pose votre amie : a-t-elle le droit de concevoir un enfant en sachant d’emblée qu’elle ne le gardera peut-être pas ?
Le diagnostic préimplantatoire permet d’éviter cela. Il s’agit d’un examen génétique, pratiqué dans le cadre d’une fertilisation in vitro et qui permet de voir avant l’implantation si un embryon est ou non porteur d’une maladie génétique grave. Actuellement cependant, cette technique est illégale en Suisse. Le projet soumis au vote ouvrirait la voie à sa légalisation.
Vu sous cet angle, le diagnostic préimplantatoire n’est pas un problème : c’est une solution. Il permettra une alternative à la ‘grossesse à l’essai’ aux parents. Il n'empêchera pas la venue au monde d'enfants qui, sans lui, seraient nés. Le DPI ne peut se faire que lors d'une fertilisation in vitro, impossible de faire ça dans une grossesse démarrée par soi-même. Et la fertilisation in vitro, on n'a le droit d'y avoir recours que si on est stérile ou s'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter la transmission d'une maladie grave à sa descendance. C'est important de le comprendre. Le DPI ne va pas servir à dépister des maladies supplémentaires par rapport à ce qui est autorisé actuellement pendant la grossesse. Il ne permet pas de faire quoi que ce soit contre des enfants. Il permet en revanche de beaucoup aider les parents. Nous cesserions de leur imposer une grossesse à l'essai.
Voilà déjà une première raison de le légaliser.
Risquer sa vie sur la mer
La catastrophe humaine se poursuit en Méditerranée, et au milieu de tout cela il y a des questions qui semblent être plus difficiles à poser que d'autres. Un bel exemple dans la vidéo qui ouvre ce message. Hans Rösling y pose une question qui semble tenir de la pure provocation: pourquoi diantre les réfugiés ne prennent-ils pas l'avion?
Je sais, la question peut choquer. Au milieu des images de naufrage en mer on a tendance à oublier le moment de l'embarquement pour se focaliser, et c'est légitime, sur les efforts de sauvetage qui restent largement insuffisants. Se demander 'pourquoi prennent-ils ces bateaux si dangereux?' plutôt que de prendre l'avion semble presque revenir à se demander pourquoi diantre les révolutionnaires français ne mangeaient pas de la brioche. Au milieu des évidences sur les raisons pour lesquelles des citoyens de
Syrie ou d'Erythrée voudraient fuir leurs pays, le premier en proie à
une guerre civile sanglante et le second à une dictature comparée à la Corée du Nord, on peut avoir tendance à se dire que, bien sûr, nous aussi on prendrait peut-être ce genre de risque pour s'échapper. Et pourtant...parfois des questions qui ont l'air bizarres méritent d'être posées. Quand on les aborde par la méthode scientifique la réponse finit parfois par être salutaire. Même quand, comme ici, elle est nettement plus dérangeante que la question. Allez écouter, et s'il vous plait venez nous dire ce que vous pensez dans les commentaires.
Éditer le génome des embryons?
Sur la question des embryons humains génétiquement modifiés par des chercheurs chinois, il y a forcément un peu plus à dire que le temps qu'on vous donne aux nouvelles. Du coup (je soupçonne ici que ce n'est pas seulement moi) on sort un brin frustré. Voici donc quelques commentaires en plusde la video et quelques explications.
La première chose qu'il faut savoir, c'est que la technique utilisée commence par couper dans le génome avant d'y insérer un gène corrigé. Elle été inventée par deux femmes pour une application chez les bactéries, mais en fait la technique peut en théorie être utilisée dans n'importe quelle cellule.
Et là, des chercheurs de l'Université Sun Yat-sen University à Guangzhou ont pratiqué une expérience pour voir ce que cela donnerait sur des embryons humains.
La deuxième chose à savoir, c'est que cela n'a pas très bien marché. Certains embryons n'ont pas survécus, d'autres n'étaient pas modifiés, ceux qui l'étaient n'avaient souvent pas la modification attendue. Si cette expérience a montré quelque chose, donc, c'est d'abord à quel point la technique est immature.
La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que cela fait un certain temps que la manipulation génétique des embryons humains est considérée comme quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Pourquoi? Parce que si l'on procède à une manipulation génétique sur un embryon humain et que tout ne se passe pas exactement comme prévu, alors le risque est énorme. Si cet embryon est implanté, se développe et arrive jusqu'au terme d'une grossesse, bref devient une personne comme vous et moi, alors cette personne devra subir toute sa vie d'éventuels effets secondaires. Ce fardeau risque en plus d'être ensuite transmis aux générations futures.
Le résultat, c'est qu'un certain nombre de pays ont tout bonnement interdit la manipulation génétique germinale : celle qui touche aux cellules reproductives. En Suisse, l'article 119 de la Constitution fédérale stipule entre autres que "toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites".
Ici cependant, non seulement ces embryons n'ont pas été implantés mais ils n'auraient pas pu se développer jusqu'à terme. Les risques n'auraient donc existé ni pour une personne future ni pour les générations futures.
La quatrième chose à savoir, c'est que sur la base des craintes soulevées par la manipulation génétique des embryons humains, la communauté scientifique est en plein appel au moratoire. Des éditoriaux parus coup sur coup dans Nature et Science ont appelé à la prudence, et à ce que la communauté scientifique s'abstienne pour le moment de certaines applications de cette technologie. Et c'est bien le hic: c'est au milieu de ces appels et avant qu'une décision n'ait été prise que cette expérience a été publiée.
La réaction ne s'est pas faite attendre (par exemple ici, ici, ici) En attendant cependant, il semble que d'autres groupes soient prêts à emboîter le pas et à chercher à améliorer la technique. La communauté scientifique, qui s'est déjà imposé des moratoires dans le passé, va-t-elle être en mesure de définir et d'implémenter une limite dans ce cas? Cela ne sera peut-être pas suffisant, mais ce serait déjà pas mal. Car c'est finalement un test, que ce cas. Sur les dernières décennies, la communauté scientifique s'est beaucoup décentralisée. Va-t-elle néanmoins être capable de décider d'un moratoire et d'en définir les paramètres? Le Dr Baltimore, un des auteurs d'appels au moratoire, dit compter pour cela sur l'autorité morale des États-Unis. Sans doute voit-on cela d'un autre œil en Chine. Mais alors comment faire, dans un monde devenu si multilatéral? Ce n'est pas seulement un enjeu éthique qui se joue là. C'est un cas d'espèce où l'on sent bouger les rapports de pouvoir du monde.
Mes collègues: autoriser le DPI
"Certains considèrent que l’embryon marque le début de la vie et qu’il est sacré, quel que soit le nombre de cellules qui le composent. Dès lors, ces personnes refusent l’avortement, qu’il soit effectué sur un embryon ou un fœtus. De même, elles s’opposent au diagnostic effectué sur un embryon en laboratoire avant implantation dans l’utérus (diagnostic préimplantatoire ou DPI). Le plus souvent, leur opposition est totale, peu importe le motif médical qui sous-tend le DPI. Leur position est cohérente: la vie est absolument sacrée.Pour ceux qui n’ont pas ces convictions, il paraît difficile de s’opposer au DPI. Pourtant plusieurs groupes, notamment ceux représentant les intérêts de personnes handicapées, se sont récemment élevés contre le vote du parlement fin 2014 révisant la loi sur la procréation médicalement assistée; il est prévu de lever l’actuelle interdiction totale du DPI et d’autoriser celui-ci notamment pour dépister des trisomies. Leurs critiques se heurtent pourtant aux arguments suivants."
De battre mon coeur s'est arrêté
Ils font une drôle de tête, les étudiants en médecine. Et si eux ne comprennent pas, comment feront les autres ? Je viens de leur raconter, dans un séminaire sur la mort cérébrale, que la première européenne pour la transplantation cardiaque après arrêt circulatoire vient d’être réalisée en Angleterre.
«Si c’est l’arrêt cardiaque qui a causé la mort, comment ça se fait qu’on puisse ensuite le greffer à quelqu’un d’autre ?». La question démarre en fait une étape avant. Quand sait-on que nous sommes réellement morts ? Hier, les «croque-morts» croquaient littéralement les cadavres au pied, aujourd’hui on est mort lorsque meurt notre cerveau. Plus exactement, c’est notre tronc cérébral qui meurt et avec lui la capacité intégrative sur les fonctions vitales. L’organisme cesse de fonctionner comme un tout. Nos cellules et certains organes ont beau demeurer quelques temps fonctionnels, nos parties ont commencé leurs chemins séparés vers d’autres existences.
Comprendre la mort cérébrale n’est pas une évidence. Sous ventilation mécanique, un mort semble presque dormir. Une fois qu’on a compris que la mort est bien là, cependant, on comprend facilement que ses organes encore fonctionnels pourraient poursuivre leur chemin non pas vers la terre mais vers un autre corps dont les fonctions intégratives seraient, elles, intactes.
Mais si c’est le cœur qui a cessé de battre, alors, comment le greffer ensuite ? S’il est suffisamment intact, comment peut-on dire que la mort était irréversible ? Sauf que, lorsque c’est le cœur qui s’arrête en premier, le cerveau le suit au bout d’un maximum de dix minutes. La mort de la personne est donc toujours cérébrale et c’est elle qui est irréversible ; il y a simplement plusieurs manières d’y arriver.
«Mais alors comment se fait-il que le cœur s’arrête et ne reparte pas, s’il est encore fonctionnel ?» Le don d’organes après arrêt circulatoire peut exister lorsque les tentatives de réanimation ont échoué. Mais il peut aussi exister lorsqu’on a arrêté ces tentatives pour ne pas conduire un patient dans l’acharnement thérapeutique. Aurait-on pu faire repartir son cœur après l’arrêt cardiaque ? Parfois, oui, et si on l’avait fait dans les minutes qui suivent le patient ne serait pas mort. Aurait-on aidé le patient par ce moyen ? Justement, non. Comment sait-on que la décision de ne pas réanimer n’a pas été influencée par le don d’organes ? Et vous, si vous aviez devant vous une personne gravement malade et que vous pouviez sauver, vous la sacrifieriez? Et pour un inconnu? Bien sûr que non. Non seulement il est impensable pour une équipe médicale de 'lâcher' un malade parce qu'il serait donneur, mais en plus on met leur indépendance sous protection supplémentaire en les ségréguant des équipes qui soignent les receveurs. Les équipes s’occupant du receveur et du donneur sont différentes et cette indépendance est protégée en Suisse par la loi. Mais la possibilité du don d’organes repose effectivement sur cette confiance.
Le trouble des étudiants est compréhensible. Le don d’organes après arrêt cardiaque soulève une série de difficultés éthiques dont la résolution n’est pas évidente. L'Académie Suisse des Sciences Médicales en a traité, et le Conseil d'éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève aussi, en 2011 et en 2014. A ce prix, pourquoi va-t-on de l’avant ? C’est que de ne pas le faire pose aussi problème. En apprenant à renoncer à l’acharnement thérapeutique, on apprend à s’arrêter avant la mort cérébrale et du coup on en réduit la fréquence. On le voit : les pays qui s’acharnent davantage sont également ceux où le taux de dons d’organes est le plus élevé. Un résultat doux-amer, tant pour les receveurs qui attendent plus longtemps que pour les donneurs potentiels qui souvent souhaitent l’être en cas de décès et là ne le peuvent plus. Cette situation, le don après arrêt circulatoire pourrait la résoudre, mais seulement si nous sommes aussi en mesure de résoudre les difficultés qu’il soulève à son tour. Un vrai défi, que ces étudiants devront peut-être continuer de relever.
Mes collègues: Nous devrions nous intéresser à Amsterdam
Il n'empêche que vous devriez être abonnés à la Revue, qui est vraiment intéressante et traite souvent de sujets semblables à ceux que je met ici.
Pour aujourd'hui, un sujet important: l'orientation des universités...
"Occupations de bâtiments universitaires à Amsterdam et Londres, grèves des enseignants précaires aux universités d’York et de Toronto. Manifestations et échauffourées à Montréal. Depuis quelques semaines, on peut se demander si Mai 68 est de retour. En fait, ce n’est pas si simple.
Prenons l’exemple d’Amsterdam. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est un programme drastique de réductions des coûts du fait d’une situation financière critique de l’Université d’ Amsterdam, qui semble elle-même liée à une politique immobilière dont les audaces font controverse depuis plusieurs années. S’ensuivirent des occupations de bâtiments, des rencontres musclées avec la police, des procédures judiciaires… Actuellement, les revendications des occupants du Maagdenhuis, immeuble administratif de l’Université d’Amsterdam, sont épouvantablement subversives : une enquête indépendante sur la situation financière de l’Université, le réexamen de coupes sombres dans les départements de sciences humaines, des conditions de travail moins précaires pour le personnel temporaire… Autrement dit, exception faite d’une frange radicale, il n’est plus question de changer le monde.
C’est qu’en réalité, les révolutionnaires sont dans l’autre camp. Car c’est bien la transformation des universités nord-américaines et de leurs imitateurs qui relève de la révolution néolibérale. Du même coup, les revendications des étudiants et d’une partie du corps enseignant apparaissent comme défensives, attachés qu’ils sont à une idée de l’université que les nouveaux révolutionnaires considèrent comme dépassée.
Le fer de lance de cette révolution, c’est la financiarisation de l’université. Menée comme une entreprise privée, obsédée de marketing, elle est en permanence à la recherche de nouveaux revenus. Après le déclin du financement public, après avoir essuyé les contrecoups de la crise et pressuré ses étudiants par des écolages en augmentation constante, elle se lance dans des investissements de plus en plus éloignés de son centre d’activité. De plus, l’université est aussi un conglomérat de microentreprises, à savoir les groupes de chercheurs gérés par des professeurs qui passent le plus clair de leur temps à chercher de l’argent pour leurs labos. Au bas de l’échelle, il y a une piétaille d’«adjuncts» et autres enseignants précaires sur qui repose une part croissante, parfois prépondérante, de l’enseignement. Qui trouve-t-on au sommet de la pyramide ? Des mandarins choyés dans leur tour d’ivoire ? Vous n’y êtes pas. Ce sont les administrateurs surpayés qui, en une génération, ont largement pris le pouvoir, à la fois financier et idéologique : «le fondamentalisme managérial a conquis l’université».
Malgré tout, l’université européenne (hors Royaume-Uni) est encore relativement protégée. Mais la tentation est grande de suivre le même chemin, qui est en réalité celui du déclin. Le problème est que la culture managériale impressionne les esprits candides et va de pair avec une véritable présomption de compétence. Présomption d’autant plus infrangible qu’elle va à la rencontre de la crédulité des décideurs politiques.
Bien entendu, ce phénomène n’est pas propre à l’éducation supérieure et le monde de la santé connaît une évolution semblable. Nul doute que bien des analogies douces-amères viendront à l’esprit des lecteurs de cette revue.
10 choses à considérer en écrivant vos directives anticipées

Que faire lorsqu'un patient et son médecin ne sont pas du même avis sur la meilleure marche à suivre? Lorsque le patient a compris les enjeux, qu'il est capable de raisonner avec comme vous et moi, qu'il est comme on dit capable de discernement, on doit clairement admettre que c'est lui qui doit avoir le dernier mot.
Mais que faire alors lorsqu'on sait à l'avance ce que l'on veut ou non, mais qu'on risque de ne pas être capable de s'exprimer le moment venu? De nombreux pays reconnaissent alors son droit à s'exprimer par écrit, dans des directives anticipées. C'est alors considéré comme un droit de tout un chacun. En Suisse, cela va faire partie du nouveau Code civile, entré en vigueur en janvier 2013. Mais en même temps c'est un document difficile à écrire, et dont la compréhension tombe vite à côté de la plaque si on ne prend pas quelques précautions. J'en ai résumé quelques unes pour les médecins récemment, et bien sûr elles valent aussi pour les patients. L'Académie Suisse des Sciences Médicale a aussi écrit un guide pour la pratique. Mais en fait, pour rédiger ses directives anticipées, pas besoin d'être ni médecin ni patient car la première chose à se rappeler est que:
1) Avoir des directives anticipées est une bonne idée si l'on a des souhaits importants à transmettre. Il n’y a pas besoin d’être malade, ou âgé. Le bon moment pour rédiger
une directive anticipée est le moment où on a quelque chose à dire sur
ce que l’on veut dans une situation future où l'on ne pourrait pas
s’exprimer. En revanche, écrire une directive anticioée n'est important qu'à condition d'avoir quelque chose qui nous importe à y mettre. la rédiger est un droit, en aucun cas un devoir.
Ensuite, les points les plus importants à considérer sont:
2) Bien réfléchir à ce que l'on met dedans. Qu'est-ce qui m'importe vraiment? Lorsque l'on prend des décisions importantes, on réfléchit. On fait de son mieux pour s'imaginer en situation. On consulte des personnes de confiance. Les décisions qui concernent ce que l'on met dans une directive anticipée sont pour de vrai et doivent être traitées comme telles.
Et puis la question la plus difficile: est-ce que je risque de changer
d'avis une fois vraiment dans la situation que je m'imagine? Vous voyez
pourquoi c'est une réflexion à mener sérieusement.
3) En parler avec votre médecin traitant. Même si ce n’est pas requis, il est sage de se faire aider pour rédiger
des directives anticipées. Il s’agit d’y exprimer des attentes réalistes
pour des scénarios possibles, et d’exprimer sa volonté dans un langage
qui sera intelligible pour les professionnels. La plupart des personnes
auront besoin d’aide.
7) Expliquer vos raisons : cela montrera que vous avez compris les enjeux de vos choix, et permettra aux soignants de mieux respecter vos directives. Si votre description indique que vous n’avez en fait pas compris, permettre aux soignants de le voir est aussi une protection pour vous.
8) Nommer un représentant thérapeutique est souvent encore plus utile que de tenter de s’exprimer soi-même par delà la perte de la capacité de discernement. La personne désignée doit être au courant de sa désignation, du rôle que cela implique, des priorités du patient. Elle doit bien sûr être d’accord de remplir ce rôle. Son pouvoir de représentation sera prioritaire sur celui des autres proches. Il faut explorer si cela pourrait poser problème. Bref, avant de désigner une personne comme représentant thérapeutique il faut parler avec elle.
9) Indiquer dans les directives où sont les exemplaires. Si vous changez d'avis il faudra tous les remplacer par la nouvelle version et d'ici-là vous aurez peut-être oublié où ils sont.
10) Dater et signer, pour rendre la directive valable et aussi en indiquer l'âge. C'est prudent de la revisiter de temps en temps. Si vous continuez de penser la même chose, indiquez-le en renouvellant la date. Si vous avez changé d'avis, renvoyez aussi le contenu...
Car une directive anticipée ne prendra en fait effet que lorsque l'on sera soi-même devenu incapable de discernement. Tant que nous restons un interlocuteur lucide, c'est directement nous qui prendrons à la fin des décisions nous concernant. Cela signifie que l'on peut aussi à tout moment changer oralement ses directives anticipées, tant qu'on est encore capable de discernement.
Journée des femmes: le premier des droits est la survie
Mais bien sûr, l'ensemble de ce qui est discuté là, des commentaires sur les portes que l'on vous tient aux revendications salariales, partage un certain nombre de présupposés de base: en tant que femme vous avez le droit d'aller et venir dans l'espace publique, d'être éduquée, et de gagner votre vie. De manière encore plus fondamentale, vous avez le droit d'être en vie.
Ces droits qui ne sont plus en discussion, c'est parfois important de se rappeler qu'ils ne sont pas garantis à toutes. Même la simple survie ne l'est pas. La violence envers les femmes reste un problème planétaire. 38% des meurtres de femmes sont le fait de leur partenaire. D'autres sont prises pour cible en raison de leur sexe: un crime que certains tentent de rendre spécifique sous le terme de 'féminicide'. A l'échelle mondiale, ce serait des millions de femmes qui 'manquent' comme résultat cumulé du risque accru de ne pas venir au monde (des régions entières pratiquent l'avortement sélectif des foetus féminins) ou d'y mourir précocément si vous êtes de sexe féminin (un cumul de de manque d'accès aux conditions de la survie, de violences, et de risques liés à la grossesse). Alors bien sûr, tout cela est lié: la vie d'une femme sera mieux protégée si elle a accès à l'éducation et à un salaire, à des options de vie indépendante. Mais pour en arriver là il faut tout de même commencer par survivre.
La branche canadienne de Médecins Sans Frontières nous rappelle un des chapitres importants de ce dossier avec une série de récits sur la mortalité liée à l'accouchement dans les conditions qui prévalent encore trop souvent là où les caméras ne vont pas. Au total, ce serait 800 femmes qui meurent chaque jour faute d'avoir eu accès à une aide compétente pendant leur grossesse ou durant un accouchement. Si je vous demandais ce que vous alliez faire pour la journée de la femme, donner de l'argent à Médecins Sans Frontières n'est peut-être pas la première chose qui vous viendrait à l'esprit. Pourtant c'est peut-être parmi les choses les plus utiles. Pendant que vous y êtes, prenez un badge avec leur logo et faites un gentil (j'ai dit gentil) sourire à votre collègue quand vous lui tiendrez la porte...
Conflits d'intérêts
J'ai participé récemment à un colloque sur les conflits d'intérêts, et Le Temps en a publié un résumé. Vous pouvez le lire ici.
Pour mieux comprendre ce dont il en retourne, il faut savoir deux-trois choses.
D'abord, un conflit d'intérêts existe quand on est dans une situation où une chose à laquelle on ne devrait pas donner la priorité pourrait devenir prioritaire. Le fait d'être rémunéré pour pratiquer la médecine, par exemple, ne représente pas en soi un conflit d'intérêt dans la mesure où cette pratique est aussi dans l'intérêt du patient. La juste priorité n'est pas remise en cause. En revanche, vous avez un conflit d'intérêt si on vous réveille dans la nuit pour une urgence vitale et que le sommeil vous appelle juste là très fort. Là, selon votre état de fatigue, vous risquez de vous tromper de priorité.
Un conflit d'intérêts n'est donc pas toujours une question d'argent. Ce n'est pas non plus en soi en faute morale. En fait, se trouver dans des conflits d'intérêts n'est pas entièrement évitable. Dans certains cas, on les accepte pour de bonnes raisons. Un médecin sont les patients bénéficieraient d'une avancée scientifique acceptera un conflit d'intérêt en entrant en partenariat avec le fabricant d'une molécule prometteuse, et il serait problématique qu'il refuse tout partenariat de ce type. En fait il y aura faute morale dans deux cas précis: si l'on cède et que l'on met la mauvaise priorité, ici par exemple si la molécule ne marche pas et que le médecine le cache pour avantager le fabricant, ou si l'on accepte un conflit d'intérêt alors qu'en fait il rendra impossible ou trop difficile le maintien des bonnes priorités.
Du coup, le fait que des conflits d'intérêts existent n'est pas tellement le problème. Non. Les problèmes commencent quand on surestime nos propres capacités à ne pas tomber dans le piège. Quand on ne met pas sur pied des protections suffisantes. Quand on compte sur notre fibre morale et sur elle seule pour régler le problème. C'est une forme de manque d'humilité, ça, et elle est très répandue. Elle l'est d'autant plus que nos discours insistent sur le fait qu'il suffirait d'être quelqu'un d'intègre pour être protégé contre les pièges des conflits d'intérêts. Mais parfois cela reviendrait à penser qu'il suffit d'être 'quelqu'un de sportif' pour être en mesure de battre un record au sprint...
La video? C'est une émission satyrique sur le marketing pharmaceutique aux médecins. Elle est excellente et vous pouvez la voir ici. Quand vous l'aurez vue, revenez nous dire ce que vous en pensez!
Vrais et faux enjeux du transfert mitochondrial
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun enjeu éthique là derrière, bien sûr. J'ai participé ce matin à un débat à la radio sur la question, que vous pouvez écouter ici. Plusieurs enjeux y sont parcourus: la question des risques de la technique, d'éventuelles dérives eugéniques, la rareté des cas et la prise en charge des maladies rares, l'éventualité que cette technique ne serve à l'avenir à permettre des grossesses chez des femmes dont la fertilité diminue avec l'âge, et les enjeux liés au don d'ovocytes.
Un chapitre insuffisamment examiné, celui du don d'ovocytes. Il est interdit en Suisse et du coup il fait l'objet d'un tourisme de la reproduction. Ce tourisme soulève des enjeux lourds car dans un certains nombre de pays la vente d'ovocytes est pratiquée. Dans les pays pauvres, cela donne lieu à des situations d'exploitation réelles. Dans les pays riches, cela donne lieu à des négociations parfois houleuses et...racistes.
Et puis encore: nous avions décidé de ne pas procéder à des manipulations génétiques germinales, qui seraient transmises à la génération future. Avons-nous ici franchi cette limite? Certains, c'est clair, pensent que oui. Des députés Européens ont fustigé la Grande Bretagne, qui a accepté le transfert mitochondrial, en avançant qu'elle aurait 'commencé une course vers le bas en ce qui concerne la dignité humaine'. Mais en même temps, c'est une forme bien particulière de manipulation génétique. On ne touche pas au génome du noyau. On ne touche pas non plus au génome des mitochondries. On met en fait en présence un noyau d'une part et des mitochondries d'autre part, qui n'ont pas été combinées par la reproduction 'naturelle' mais qui auraient pu. Et tout cela sans toucher ni à l'ADN lui-même, ni aux caractéristiques personnelles de l'enfant futur. Avouez que ce n'est pas si évident qu'il s'agisse de manipulation génétique du tout, en fait.
Bref, toute une série d'enjeux dont chacun aurait pu faire l'objet d'une émission à lui tout seul. Si vous avez le temps d'aller écouter, revenez nous dire ce que vous en pensez...